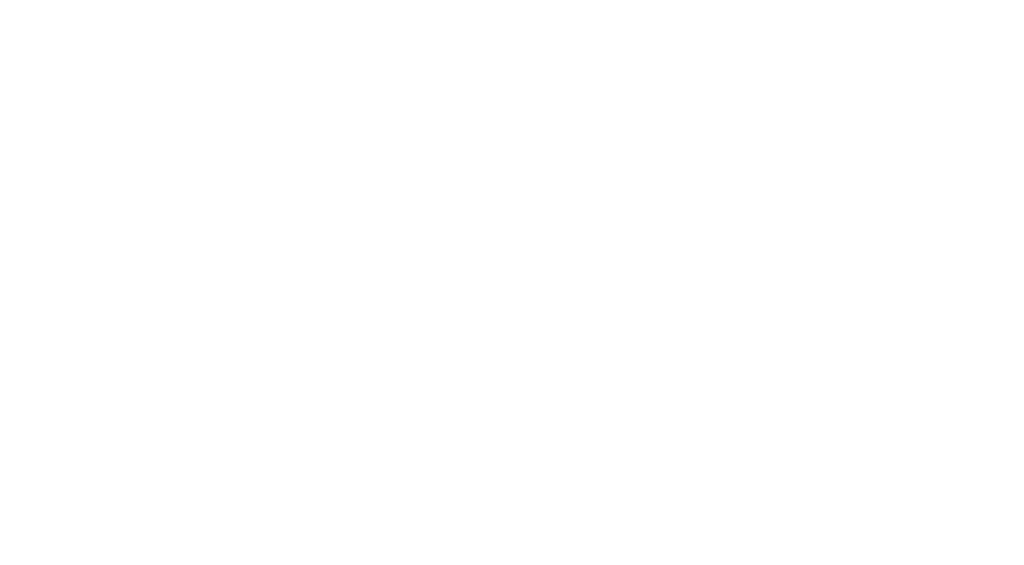Ghassan SalamГ©, ministre de la Culture : Je suis le mendiant de la RГ©publique
Propos recueillis par
Maya GHANDOUR HERT
C’est à la Bibliothèque nationale, à Sanayeh, que Ghassan Salamé s’est installé. Plus près des livres ? « Je n’ai jamais été loin des livres », sourit le politologue et diplomate libanais, né le 1er septembre 1951. Le professeur émérite de relations internationales à Sciences Po Paris – où il a fondé et dirigé la Paris School of Internatio-nal Affairs (PSIA) – avait déjà tenu le portefeuille de la Culture de 2000 à 2003. En janvier 2025, il a été nommé de nouveau à ce poste dans le gouver-nement de Nawaf Salam. Depuis sa prise de fonction, il s’est engagé à revitaliser le secteur culturel libanais, en mettant l’accent sur la préservation du patrimoine, le soutien aux artistes et la promotion de la culture libanaise à l’international. Récemment, il a visité des sites archéologiques endomma-gés au Liban-Sud, notamment à Tyr et dans les villages voisins, et a pro-mis d’œuvrer à leur reconstruction en collaboration avec des organisations internationales, dont l’Unesco. Sur le plan international, Ghassan Salamé a été conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan de 2003 à 2007 et a servi comme envoyé spécial des Nations unies en Libye de 2017 à 2020. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages et essais sur le monde arabe et les relations interna-tionales.
Dans un entretien avec L’Orient-Le Jour, il détaille en exclusivité son approche qu’il voudrait axée sur la transparence, la protection du pa-trimoine et la recherche de finan-cements innovants, tout en réta-blissant la confiance des partenaires internationaux. Il montre également une vision claire des priorités, mais reconnaît les limites structurelles et les défis auxquels son ministère est confronté.
Vous revenez au Liban après plu-sieurs années passées à l’étranger. Quel regard portez-vous sur l’état de la scène culturelle actuelle ?
J’étais loin, entre l’Irak, la Libye, le Myanmar et d’autres régions en crise. Je n’étais donc pas informé de l’évo-lution de la scène culturelle libanaise ces dernières années. Mais en reve-nant, j’ai d’abord découvert un palais de l’Unesco dans un état lamentable. Il pleuvait à l’intérieur du bâtiment – qui abrite les locaux du ministère de la Culture mais aussi un grand amphi-théâtre –, notamment dans toute la partie nord. Ma priorité actuelle est la restauration de ce lieu qui a souffert de l’absence totale d’entretien pendant des années. C’est un immeuble d’une importance capitale. J’ai déjà obtenu une partie du financement, mais il me manque encore environ un million et demi de dollars pour réhabiliter l’en-droit.
En attendant, vous avez instal-lé une partie de vos bureaux à la Bibliothèque nationale. Quels sont vos projets à son sujet ?
La Bibliothèque nationale est bien restaurée, mais elle manque de dy-namisme. Je veux en faire un espace culturel vivant avec une programma-tion riche et diversifiée. J’ai conçu un programme qui s’étendra sur un an, avec plus d’une centaine d’événements prévus. Tous les acteurs sollicités ont répondu présent, bien que certains aient besoin d’un soutien financier. Mon objectif est de transformer la Bibliothèque nationale en un centre culturel majeur.
Ce lieu doit vous être particulière-ment significatif puisque vous êtes à l’origine de son projet de réhabili-tation. Pouvez-vous revenir sur cette initiative ?
Lorsque j’ai été nommé ministre pour la première fois en 2000, j’ai de-mandé où se trouvaient les livres de la Bibliothèque nationale. Après des recherches, j’ai fini par les retrouver dans un entrepôt en ruine. L’odeur de moisissure y était insoutenable. Ne sachant pas par où commencer, j’ai sollicité l’Union européenne, qui nous a accordé un financement de 1,2 million d’euros pour restaurer ces livres. La procédure était chimiquement complexe et dangereuse, et nous avons donc dû déplacer les ouvrages. J’ai trouvé des locaux inoccupés apparte-nant au ministère des Transports près du port de Beyrouth et les ai loués symboliquement pour une livre liba-naise par an.
Parallèlement, j’ai sollicité un soutien du Qatar pour la restauration de l’ancien bâtiment de la faculté de droit. Finalement, la Bibliothèque na-tionale a été réinstallée, mais elle doit évoluer avec les innovations technolo-giques pour rester pertinente.
Parmi vos réalisations figure égale-ment le réseau des CLAC (Centres de lecture et d’animation culturelle). Quel est leur état aujourd’hui ?
Je suis en colère. J’étais très fier des CLAC, que j’avais soigneuse-ment répartis sur l’ensemble du ter-ritoire pour éviter la concentration culturelle à Beyrouth. Certains ont fonctionné magnifiquement bien, comme celui de Bint Jbeil, détruit en 2006 par les bombardements israéliens, puis reconstruit par la municipalité et les habitants sans aide extérieure.
Aujourd’hui, cependant, je constate que de nombreux CLAC sont à l’abandon. Certains ont fer-mé, d’autres utilisent encore du matériel informatique vieux de vingt ans. Je vais discuter avec l’Organisa-tion internationale de la francopho-nie pour voir comment nous pou-vons revitaliser ces centres avec un concept plus adapté à notre époque.
Quel bilan dressez-vous des dernières années au ministère de la Culture ?
Il serait facile de critiquer mes pré-décesseurs, mais je préfère me concen-trer sur les défis actuels. J’ai beaucoup de batailles à mener. Contrairement à d’autres secteurs, le monde cultu-rel libanais ne s’est pas effondré car il repose sur des initiatives privées et une résilience exceptionnelle. Les artistes et intellectuels libanais ont su s’adapter. Toutefois, le secteur institu-tionnel de la culture a gravement souf-fert. Depuis mon départ, la part de la culture dans le budget national n’a cessé de baisser, et les lois que j’avais mises en place au début des années 2000 ont été mal appliquées.
L’administration culturelle est si-nistrée, notamment en raison des sa-laires dérisoires des fonctionnaires et de l’absence de véritable gouvernance. La culture souffre donc comme l’en-semble de l’administration publique, mais sa vitalité intrinsèque lui permet de résister mieux que d’autres sec-teurs.
Devant l’étendue du désastre si l’on peut dire, quelles sont vos priorités principales pour les mois à venir. Pouvez-vous développer chacune d’elles ?
Bien sûr. Mes priorités sont claires et reflètent les besoins urgents du secteur culturel libanais. Elles se concentrent sur la protection du patrimoine, la revitalisation des institutions culturelles et le soutien à la créativité artistique.
La protection du patrimoine est une priorité absolue. Depuis mon retour, j’ai constaté des violations inac-ceptables : des projets immobiliers qui empiètent sur des sites historiques, des fouilles archéologiques négligées et un manque de coopération interna-tionale pour préserver notre mémoire collective. Par exemple, j’ai déjà arrêté la transformation d’un site historique en parking et stoppé des projets qui menaçaient des lieux emblématiques.
Je compte également lancer de nouvelles fouilles archéologiques, notamment à Beyrouth et dans d’autres régions-clés. Nous devons explorer et préserver notre histoire, car c’est une question de souveraineté et d’identité. Je vais aussi engager des discussions internationales, voire intenter des procès si nécessaire, pour réparer les dommages causés par des destructions passées, comme celles perpétrées par les frappes israéliennes en 2024.
Enfin, je veux créer un nouveau musée d’archéologie à Saïda et ren-forcer celui de Beyrouth. Ces lieux ne doivent pas seulement être des dépôts d’artefacts, mais des espaces vivants qui racontent notre histoire aux géné-rations futures.
Ma deuxième priorité consiste à revitaliser les institutions culturelles. La Bibliothèque nationale est un sym-bole fort de cette priorité. Je veux par ailleurs unifier les festivals littéraires. Actuellement, il y a plusieurs Salons du livre concurrents, ce qui dilue leur impact. Mon projet est de créer un festival plurilingue, qui reflète la di-versité culturelle du Liban et attire des auteurs de renommée internationale.
La créativité est l’âme de la culture, et elle doit être soutenue. Le théâtre, par exemple, est l’un des secteurs les plus florissants, mais aussi l’un des plus pauvres. Les troupes ont besoin de mobilité pour se produire hors de Beyrouth et toucher un public plus large. J’avais déjà établi un budget pour la mobilité des troupes et je compte relancer cette initiative.
Pour le cinéma, nous devons encourager la production de films, notamment en soutenant l’écriture de scénarios. Nous devons intégrer l’en-seignement du scénario dans les écoles d’art. Nous devons aussi soutenir les documentaristes libanais, qui sont très talentueux, et les aider à se faire une place sur la scène internationale.
Enfin, je veux m’attaquer aux pro-blèmes du Conservatoire et de l’Or-chestre national. Le Conservatoire souffre de problèmes d’équivalence des diplômes, ce qui pénalise les étu-diants. J’ai déjà discuté avec la ministre de l’Éducation pour résoudre ce pro-blème. Quant à l’Orchestre national, il doit mieux intégrer les talents libanais et se produire plus souvent, à la fois au Liban et à l’étranger.
Ces priorités semblent ambitieuses. Comment comptez-vous les concréti-ser dans un délai aussi court ?
Je suis conscient du défi. Nous avons 15 mois pour poser les fondations. Mon approche est de diviser les pro-blèmes en trois catégories : ceux que nous pouvons résoudre entièrement, ceux que nous pouvons commencer à résoudre et ceux que nous devons planifier pour l’avenir. Par exemple, je veux absolument régler le problème du palais de l’Unesco d’ici à la fin de mon mandat. Pour d’autres projets, comme les fouilles archéologiques ou la création d’un nouveau musée, je veux poser les bases pour que mon successeur puisse les achever.
L’important est de montrer que nous sommes sérieux, transparents et déterminés. Si nous réussissons à réta-blir la confiance, les financements sui-vront. Et avec un peu de chance, nous pourrons laisser le secteur culturel en meilleur état que nous l’avons trouvé.
Vous avez évoqué la nécessité de trouver des financements pour vos projets. Comment comptez-vous rele-ver ce défi, surtout dans un contexte où la confiance des donateurs internationaux est ébranlée ?
Le financement est effectivement l’un des défis majeurs. Je suis le mendiant de la République. Aujourd’hui, le budget alloué à la culture repré-sente moins de 0,3 % du budget national. C’est insuffisant. Lors de mon premier mandat, nous avions réussi à atteindre 0,6 %, mais au-jourd’hui, je pense que nous devons chercher des sources de financement extra-budgétaires. Cela passe par des partenariats internationaux, des dons privés et une collaboration étroite avec la diaspora libanaise.
Quels sont les obstacles majeurs aux financements internationaux ?
Le premier obstacle, c’est la perte de confiance. Après l’effondrement financier et les scandales de corruption, beaucoup de pays et d’organisations internationales hésitent à investir au Liban. Ils ont vu des aides promises après l’explosion au port de Beyrouth ne jamais atteindre leurs destinataires. Ils ont vu des fonds détournés ou mal utilisés. Aujourd’hui, les donateurs ne veulent plus simplement donner ; ils veulent investir. Ils exigent des ré-formes, de la transparence et des ga-ranties que leur argent sera utilisé à bon escient.
Un autre obstacle, c’est la concurrence. Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d’aide. La facture de la reconstruction à Gaza est estimée à 60 milliards de dollar, et celle de la Sy-rie à 250 milliards. Nous sommes en compétition avec nos voisins pour les mêmes sources de financement. Les pays du Golfe, l’Union européenne, les organisations internationales… tous ont des priorités multiples. Nous devons donc être convaincants et montrer que notre projet culturel a une valeur unique.
Comment faire pour gagner la confiance des bailleurs de fonds ?
Pour regagner la confiance, nous devons être irréprochables en ma-tière de transparence. Je déteste parler du passé, mais il y a 20 ans, j’ai organisé deux grands sommets culturels sans dépenser un sou de l’État libanais. J’ai même remis 430 000 dollars au ministère des Finances après ces événements. Aujourd’hui, ce genre de réussite est plus difficile, car la confiance n’est plus là. Mais nous devons montrer que nous pouvons gérer les fonds de manière responsable. Cela signifie mettre en place des mécanismes de contrôle stricts, publier des rapports détaillés sur l’utilisation des fonds et impliquer des observateurs interna-tionaux si nécessaire. Nous devons aussi montrer que nous prenons nos responsabilités. Par exemple, avant de demander de l’aide extérieure, nous devons commencer par mobili-ser des ressources locales. La diaspo-ra libanaise est un atout formidable. Beaucoup de Libanais à l’étranger sont prêts à contribuer à la recons-truction de leur pays, mais ils veulent voir des projets sérieux et bien gérés.
Pour conclure, comment voyez-vous l’avenir des financements pour la culture au Liban, vous qui vous dites « le mendiant de la République » ?
L’avenir dépend de notre capacité à rétablir la confiance, à montrer que nous sommes sérieux et à mobiliser toutes les ressources disponibles, à la fois locales et internationales. Nous devons aussi repenser notre relation avec l’État. Les Libanais ont tendance à se détourner de l’État, à compter sur eux-mêmes pour tout : l’électricité, l’eau, l’éducation… Mais la culture, elle, ne peut pas survivre sans un État fort et engagé. Nous devons donc reconstruire ce contrat social, où l’État joue son rôle de protecteur du patri-moine et de promoteur de la culture. Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est essentiel pour l’avenir de notre pays. Et si nous réussissons, je suis convain-cu que le Liban retrouvera sa place sur la scène culturelle internationale. Pas comme le « centre du monde » qui flatte notre ego (rires), mais comme un acteur respecté et inspirant.